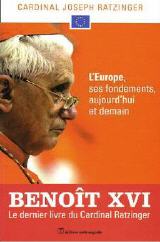Qu'est-ce que l'Europe ? (II)
Deuxième partie de la conférence donnée le 13 mai 2004 par le cardinal Ratzinger devant le Sénat italien: L'universalisation de la culture européenne et sa crise.
>>> Première partie: Qu'est-ce que l'Europe ? (I)
Étrange absence de préoccupation de l'avenir ! Les enfants, qui sont le futur, se voient considérés comme une menace pour le présent ; on s'imagine qu'ils nous volent quelque chose de notre vie. Ils ne sont pas perçus comme une espérance, mais comme un rétrécissement du présent. S'impose alors le parallèle avec l'Empire romain décadent : il fonctionnait encore comme un grand tout historique, mais, en réalité, il vivait déjà de ce qui allait le faire disparaitre, car il n'avait en lui-méme plus aucune énergie vitale.
3. L'universalisation de la culture européenne et sa crise
Il nous faut encore considérer un ultime processus par lequel l'Histoire des derniers siècles nous conduit dans un monde nouveau. Avant l'époque moderne, la vieille Europe, avec ses deux moitiés, n'avait connu, essentiellement, qu'un seul adversaire, auquel il lui fallut se confronter pour la vie et pour la mort, c'est-à-dire le monde de l'Islam. A l'époque moderne il y eut un tournant, ce fut l'élargissement vers l'Amérique et un peu vers l'Asie, sans grands apports culturels (contrairement à aujourd'hui), grâce à l'ouverture à ces deux continents, peu touchés jusqu'alors, si ce n'est de façon marginale : l'Asie et l'Afrique, qui désormais sont en train de devenir tous deux des succursales de l'Europe, des colonies. Cela s'est avéré jusqu'à un certain point, dans la mesure où, aujourd'hui, même l'Asie et l'Afrique sont à la remorque de l'idéal du monde façonné par la technique et le bien-être, de telle sorte que même là-bas les traditions religieuses connaissent une situation de crise, et que les courants de pensée purement séculière dominent toujours davantage la vie publique.
Cependant, il existe un autre effet contraire : la renaissance de l'Islam n'est pas seulement liée à la nouvelle richesse matérielle des pays islamiques, elle est encore alimentée par la conscience de ce que l'Islam est en mesure d'offrir une base spirituelle importante pour la vie des peuples, une base qui semble avoir échappé à la vieille Europe qui, par conséquent, nonobstant sa puissance politique et économique, semble toujours plus condamnée au déclin et à la disparition.
De même, les grandes traditions religieuses de l'Asie - en particulier la composante mystique exprimée dans le bouddhisme - deviennent des forces spirituelles face à une Europe qui renie ses fondements religieux et moraux. Au début des années 60, l'historien Arnold Toynbee pouvait encore nourrir son optimisme en la victoire de l'élément européen ; aujourd'hui, cet optimisme semble étrangement dépassé : « Nous avons identifié vingt-huit cultures... dix-huit sont mortes, et neuf des dix restantes - en fait, toutes sauf la nôtre - montrent qu'elles sont déjà mortellement atteintes. »
Qui redirait la même chose, aujourd'hui ? Quelle est cette culture, la nôtre, qui est encore vivante ? La culture européenne est-elle la civilisation de la technique et du commerce victorieusement répandue à travers l'univers entier ? N'est-elle pas plutôt née, de façon post-européenne, de la mort des anciennes cultures d'Europe?
Je vois là un synchronisme paradoxal : d'un côté, il y a la victoire du monde technico-séculier post-européen, l'universalisation de son modèle de vie, de sa façon de penser ; et en même temps, dans le monde entier, mais surtout dans les pays tout à fait non européens de l'Asie et de l'Afrique, on a l'impression que l'ensemble des valeurs de l'Europe, sa culture, sa foi, tout ce sur quoi repose son identité, que tout cela arrive au bout, et soit même déjà sorti de scène. Nous sommes arrivés à l'heure des systèmes de valeurs d'autres mondes : Amérique précolombienne, Islam, mystique d'Asie.
A l'heure même de sa suprême réussite, l'Europe semble devenue intérieurement vide, comme paralysée, en un certain sens, par une crise de son système circulatoire, crise qui compromet sa vie ; on veut la pallier par des transplantations qui ne peuvent, finalement, qu'abolir son identité. A cette diminution de ses forces spirituelles fondamentales correspond le fait que, sur le plan ethnique, l'Europe semble en voie de disparition.
Étrange absence de préoccupation de l'avenir ! Les enfants, qui sont le futur, se voient considérés comme une menace pour le présent ; on s'imagine qu'ils nous volent quelque chose de notre vie. Ils ne sont pas perçus comme une espérance, mais comme un rétrécissement du présent. S'impose alors le parallèle avec l'Empire romain décadent : il fonctionnait encore comme un grand tout historique, mais, en réalité, il vivait déjà de ce qui allait le faire disparaitre, car il n'avait en lui-méme plus aucune énergie vitale.
Nous voici donc parvenus aux problèmes actuels. Au sujet de l'avenir de l'Europe, deux diagnostics opposés sont possibles.
D'un côté, nous avons la thèse d'Oswald Spengler ; il croyait pouvoir établir, pour les grandes expressions culturelles, une sorte de loi naturelle : il y a le temps de la naissance, celui de la croissance graduelle, celui de l'épanouissement d'une culture, puis de l'alourdissement, du vieillissement et de la mort. Spengler enrichit sa thèse de façon impressionnante, par des documents tirés de l'histoire des cultures, où l'on peut entrevoir cette loi du cours naturel des choses. Sa thèse était que l'Occident atteint sa période finale et court, inexorablement, vers la mort de ce continent culturel, en dépit de toutes les tentatives contraires. Certes, l'Europe peut transmettre ses dons à une nouvelle culture qui émerge, comme cela s'est déjà produit en d'autres circonstances analogues, mais à la condition que cette culture ait devant elle du temps pour se développer.
Cette thèse, marquée par la biologie, a rencontré, entre les deux guerres, des oppositions passionnées, spécialement dans les milieux catholiques ; s'est dressé contre elle, de façon impressionnante, Arnold Toynbee, avec des arguments qui, certes, trouvent peu d'audience aujourd'hui. Toynbee met en lumière la différence entre progrès matériel technique et progrès réel, qu'il définit comme spiritualisation. Il admet que l'Occident - le monde occidental - passe par une crise : la cause en est, à ses yeux, le fait que l'on est tombé de la religion au culte de la technique, de la nation, du militarisme. Pour lui, la crise, en dernier ressort, est la sécularisation.
Connaître la cause de la crise permet de désigner le chemin de la guérison : il faut, à nouveau, réintroduire le facteur religieux, auquel appartient, selon lui, l'héritage religieux de toutes les cultures, mais spécialement ce qui est resté du christianisme occidental. A la vision biologique s'oppose donc une vision volontariste, qui s'appuie sur la force des minorités capables de créer, et sur quelques personnalités exceptionnelles.
Une question se pose : ce diagnostic est-il juste ? Et si oui, est-il en notre pouvoir d'introduire à nouveau l'instance religieuse, grâce à une synthèse du christianisme résiduel et de l'héritage religieux de l'humanité ?
En définitive, la question entre Spengler et Toynbee reste ouverte, car nous ne pouvons pas lire dans le futur. Mais, indépendamment de cela, reste le devoir de s'interroger sur ce qui est susceptible d'assurer l'avenir, sur ce qui est en mesure de continuer à maintenir en vie l'identité profonde de l'Europe à travers toutes les métamorphoses de l'Histoire. Disons plus simplement qu'est-ce qui, aujourd'hui et demain, promet d'assurer la dignité humaine, et une existence qui lui soit conforme ?
Pour répondre, il nous faut, encore une fois, porter notre regard au cœur du présent, tout en nous rappelant ses racines historiques. Tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés, en effet, à la Révolution française et au XIXe siècle.
En ce temps-là, se sont développés, en particulier, deux nouveaux modèles européens.
Voici donc, dans les Nations latines, le modèle laïque : l'État est nettement distinct des organismes religieux qui sont relégués dans le cadre du privé. L'État lui-même refuse un fondement religieux, et se considère reposant, de façon exclusive, sur la raison et ses propres institutions. A cause des fragilités de la raison, ces systèmes se sont révélé frêles, et aisément victimes des dictatures ; s'ils survivent, c'est que, nés de la vieille conscience morale, ils continuent à subsister même en l'absence des fondements antérieurs et permettent un consensus moral de base.
D'autre part, le monde germanique connait, de façon différentiée, des modèles d'Église d'État dans le protestantisme libéral : nous y voyons une religion chrétienne rationnelle, conçue essentiellement comme une morale - avec même des formes de culte garanties par l'État - qui assure un consensus moral et un large fondement religieux, auquel doivent s'adapter les autres religions qui ne sont pas d'État. Ce modèle, en Grande-Bretagne, dans les États scandinaves et, autrefois, même en Allemagne prusse, a longtemps garanti une cohésion sociale et étatique. Toutefois, en Allemagne, l'écroulement du christianisme de l'État prussien a provoqué un vide qui, par après, devint un espace libre pour une dictature. Aujourd'hui, les Églises d'État sont, partout, devenues victimes de détérioration : les corps religieux dépendants de l'État ne sont plus sources de la force morale que l'État lui-même ne peut susciter ; il doit au contraire la présupposer pour construire à partir d'elle.
Entre les deux, se situent les États-Unis de l'Amérique du Nord. D'un côté - s'étant établis sur la base d'Églises libres -, ils s'inspirent d'un dogme rigide celui de la séparation ; de l'autre côté, par-delà les dénominations particulières, les États sont façonnés par un consensus fondamental chrétien protestant, non exprimé en termes confessionnels ; mais contenant la conscience particulière d'une mission, face au reste du monde, de caractère religieux, donnant ainsi au facteur religieux un poids public fort significatif : en tant que force pré politique et supra politique, il pouvait être déterminant pour la vie politique. Sans doute, il est indéniable que même les États-Unis connaissent un dépérissement constant de l'héritage chrétien ; mais, en même temps, les conditions sont transformées par la rapide croissance de l'élément hispanique et par la présence de traditions religieuses provenant du monde entier. Peut-être faut-il encore observer ici le fait que certains milieux des États-Unis promeuvent une ample « protestantisation » de l'Amérique latine et, par conséquent, la disparition de l'Eglise catholique, agissant comme Église libre ; elle est considérée comme incapable de garantir un système politique et économique stable, incapable donc de remplir le rôle d'éducatrice des Nations, alors que l'on voudrait que ce modèle d'Église libre rende possible un consensus moral et une formation démocratique des volontés publiques, pareils à ceux qui caractérisent les Etats-Unis. Pour compliquer encore davantage la situation, force est d'admettre que, aujourd'hui, l'Église catholique constitue la plus grande communauté religieuse aux États-Unis ; et que, dans sa vie de foi, elle se tient résolument du côté de l'identité catholique ; mais que, dans les relations entre Église et Politique, les catholiques restent fidèles aux traditions des Églises libres, en ce sens précis qu'une Église indépendante de l'État est plus à même d'assurer les fondements moraux de tout, si bien que la promotion de l'idéal démocratique apparait comme un devoir moral profondément conforme à la foi. On peut, à juste titre, reconnaitre en cela la continuation du modèle - mais adapté à l'époque - que traça le pape Gélase, dont j'ai parlé plus haut.
Revenons à l'Europe. Au XIXe siècle, s'est encore ajouté un troisième modèle aux deux précédents je veux parler du socialisme.
Il s'est rapidement subdivisé en deux tranches: l'une, totalitaire, et l'autre, démocratique. Le socialisme démocratique fut capable, dès son départ, de s'inscrire à l'intérieur des deux modèles existants, tel un salutaire contrepoids aux positions libérales radicales qu'il a enrichies et corrigées. De plus, il s'est révélé comme quelque chose allant au-delà des confessions : en Angleterre, il était le parti des catholiques, qui ne pouvaient pas se sentir chez eux dans le camp protestant conservateur, ni dans le camp libéral. Dans l'Allemagne des Guillaume, le milieu catholique pouvait également se voir plus proche du socialisme démocratique que des forces conservatrices, rigidement prussiennes et protestantes. Sur bien des points, le socialisme démocratique était, et reste, proche de la doctrine sociale catholique ; en tout cas, il a considérablement contribué à la formation d'une conscience sociale.
Quant au socialisme totalitaire, il se lia à une philosophie de l'Histoire fortement matérialiste et athée : - l'Histoire est comprise en termes de déterminisme, tel un processus qui va de l'avant à travers la phase religieuse, puis libérale, pour déboucher sur une société absolue et définitive, où la religion - reliquat du passé - est dépassée, et où le fonctionnement des conditions matérielles peut garantir le bonheur de tous. Cette apparence scientifique cache un dogmatisme intolérant: l'esprit n'est que le produit de la matière ; la morale dépend des circonstances, elle doit être définie et vécue conformément aux buts de la société ; tout ce qui concourt à l'avènement de l'État final heureux est moral. C'est l'absolu renversement des valeurs qui avaient construit l'Europe. Davantage encore, s'opère ici une fracture par rapport à la riche tradition morale de l'humanité : il n'existe plus de valeurs indépendantes des visées du progrès ; tout peut, à un certain moment, être permis et même nécessaire ; tout peut être moral, au sens nouveau du terme. L'homme lui-même peut devenir un instrument ; l'être singulier ne compte plus ; seul compte le futur, qui devient une terrible divinité disposant de tous et de tout.
Les systèmes communistes sombrèrent, en raison surtout de leur dogmatisme économique erroné. Mais on néglige trop facilement le fait que ces systèmes ont échoué plus encore à cause de leur mépris des droits humains, à cause de la soumission de la morale aux exigences du système et aux promesses du futur. La réelle et véritable catastrophe qu'ils ont connue n'est pas de nature économique ; elle consiste en la désertification des âmes, en l'abolition de la conscience morale.
Un problème essentiel, aujourd'hui, pour l'Europe et pour le monde entier, me semble être le fait que jamais on ne conteste le naufrage économique - c'est pourquoi les anciens communistes sont devenus, sans hésitation, les tenants du libéralisme économique, alors que la problématique morale et religieuse - qui était le nœud de la question - est presque totalement estompée. Et pourtant ! La problématique qu'a laissée derrière lui le marxisme continue d'exister actuellement : se dissolvent sans cesse les certitudes fondamentales de l'homme relatives à Dieu, à lui-même, à l'univers ; l'évanescence des valeurs morales intangibles demeure encore, en se renforçant, notre problème actuel, elle peut conduire à l'autodestruction de la conscience européenne ; il nous faut nous mettre à considérer cette situation - indépendamment du déclin conçu par Spengler - comme un réel péril.
à suivre...