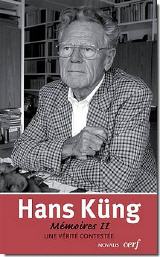Les mémoires de Hans Küng (II)
Deux autres extraits où il est question de Joseph Ratzinger, mettant en évidence le parallélisme entre deux destins (17/3/2014)
Le sous-titre du gros livre (rappelons que c'est le tome II et qu'il compte 736 pages, à comparer avec les 146 pages de l'autobiographie "Ma vie" de Joseph Ratzinger, à l'évidence le sujet préféré de Hans Küng, c'est.... Hans Küng), est "Une vérité contestée". Tout un programme.
La présentation de l'éditeur indique (ici):
Tandis que, au fil de voyages autour du monde, l'auteur se forge une réputation internationale, il élargit sa vision des choses, en particulier sur les religions du monde, et publie trois bestsellers : « Infaillible ? Une interpellation » (1970), « Être chrétien » (1974) et « Dieu existe-t-il ? » (1981).
Dans le même laps de temps, un de ses collègues de Tübingen, Joseph Ratzinger entame une carrière qui le mènera aux sommets de la hiérarchie jusqu'à son élection comme pape, sous le nom de Benoît XVI... Comment le parallélisme de ces deux parcours ne frapperait-il pas les esprits ?
Monique, qui a eu la gentillesse de photocopier ces pages pour moi, est moins sévère que moi (ou peut-être est-ce moi qui nourrit un parti-pris excessif, mais j'ai malheureusement trop bonne mémoire pour être indulgente).
Tout en convenant qu'Hans Küng se donne le beau rôle (ce qui est somme toute humain), elle remarque:
En parcourant les mémoires de Küng, je m'aperçois qu'il n'a aucune haine envers J. Ratzinger (mais beaucoup d'acrimonie envers Jean- Paul II).
Je suis même surprise de voir qu'il considère Joseph Ratzinger un peu comme un frère très brillant dont il regrette de ne pas pouvoir partager les idées.
Je recopie quelques lignes finalement assez touchantes:
"J'espère seulement que mon contemporain et compagnon de route, Joseph Ratzinger, qui a choisi un autre chemin, est aussi satisfait et heureux que je le suis, malgré toutes les souffrances." ( le livre est de 2006)
(pages 14 à 17)
«À Rome, j'ai très vite perçu que nous étions sur la même longueur d'onde, et c'était là l'essentiel », avais-je écrit au printemps 1963 au sujet de mon éventuelle nomination à Münster où enseignait déjà Joseph Ratzinger. M'étais-je trompé? Non. Ce que nous avions en commun était sûrement plus fort que ce qui nous séparait car cela se fondait sur les conditions structurellement similaires de nos origines. Personne ne peut échapper à son appartenance sociale, car celle-ci nous marque pour la vie.
Nous venions tous deux d'une famille catholique conservatrice, d'une région alpine : lui de Bavière, moi de Suisse centrale. Nous aimions tous deux la montagne et les lacs. Nous sommes du même âge, presque de la même année : Ratzinger est né le 16 avril 1927, moi le 19 mars 1928. Mais il est évident que nous n'avons pas grandi dans le même cadre : lui était fils de fonctionnaire et a vécu d'abord dans une gendarmerie, puis, quand son père prit sa retraite, dans une simple ferme, enfin à partir de douze ans dans un petit séminaire, alors que j'étais moi-même fils d'un commerçant et habitais une accueillante maison bourgeoise, sur la place de la mairie, rendez-vous de toute une parenté disséminée, donc une demeure imprégnée d'une atmosphère vivante et ouverte, sans rien à voir avec une résidence sévèrement gardée de gendarmes ou d'ecclésiastiques.
Dès le départ, nous avons également profité d'une formation humaniste que nous considérions comme idéale, celle d'un lycée où le latin et le grec étaient à la base des études. Mais, au petit séminaire, simple préparation du séminaire sacerdotal proprement dit, la vie se déroulait selon une règle stricte et était évidemment totalement coupée de celle des filles. Pour ma part, j'ai passé mes classes supérieures au lycée de Lucerne, un établissement relativement libéral, dans une ambiance extrêmement positive de coéducation et de joie de vivre (ce que réprouvaient nombre de catholiques).
Ratzinger eut très vite droit à une nouvelle génération d'enseignants résolument pro-nazis, alors que mes professeurs et mes camarades d'école étaient dans l'ensemble des patriotes fermement anti-nazis. Lui ne put découvrir que beaucoup plus tard ce qu'était une démocratie libérale, expérience fort différente de celle qu'il menait sous la coupe de l'Église hiérarchique.
Nous avons tous deux été profondément marqués par les mouvements de jeunesse. Mes plus précieux souvenirs sont ceux d'excursions en montagne, de jeux de foulard, de concours, le tout accompagné de prières et de messes adaptées aux jeunes, donc dans un cadre de mouvement chrétien très libre, fort éloigné de tout idéal nazi. Mais lui ne pouvait évidemment rien faire d'autre que d'entrer dans la jeunesse hitlérienne où tout le monde devait marcher au pas. Ses tristes expériences des derniers mois de la guerre, service du travail, embrigadement dans l'armée, défense aérienne (Flak), puis captivité chez les Américains, avaient été celles de mes collègues étudiants des classes 27/28 du Collegium Germanicum. Moi, j'avais passé toute ma jeunesse en Suisse, dans un îlot de paix.
Tout au long de ces sombres années d'idéologies totalitaires, nous avions l'un et l'autre bénéficié de notre enracinement dans l'Église catholique, de son ouverture sur le monde, de son soutien moral. Nous avons l'un et l'autre été d'enthousiastes enfants de chœur. Mais, pour lui, son Église était celle du lieu, régie par un curé traditionnel, dirigée par l'archevêque de Munich. Pour moi, elle était celle d'un aumônier de jeunes qui n'avait rien de conventionnel, ni son vêtement, ni sa démarche, ni sa mentalité, bref, un convaincant apôtre de la bonne nouvelle de l'Évangile sans lequel une douzaine d'entre nous ne seraient jamais devenus prêtres. Mon Église était une Église de jeunes plus que de vieux. Si lui s'était décidé à devenir prêtre, il n'avait pas eu d'aumônier de ce genre, et son image sacerdotale idéale était donc celle d'une hiérarchie traditionnelle, figée, hiératique. Impressionné par un cardinal vêtu de pourpre, il s'était demandé : Pourquoi pas moi?
Nous avons tous les deux participé de tout cœur à la liturgie préconciliaire et nous avons été très tôt en contact avec le mouvement liturgique alors débutant. Cependant, pour, lui, cette liturgie était pleine de mystères insondables, construction aux multiples recoins dans laquelle il n'était pas toujours facile de se retrouver, mais qui n'en était que plus admirable et qui constituait sa patrie. Quant à moi, j'ai profité à l'Université grégorienne d'un cours de liturgie où on nous initiait aux recherches du plus éminent spécialiste de l'époque, Joseph Andreas Jungmann, dont jamais Ratzinger n'a mentionné l'ouvrage fondamental, Missarum Solemnia. Cet historien rigoureux, avocat d'une liturgie populaire, lui aurait expliqué ce qu'était originellement la célébration eucharistique, une fête simple et compréhensible, mais il lui aurait aussi fait voir tout ce qu'on y avait surajouté, formes et contenus gratuits, des nouveautés si problématiques qu'elles tournaient parfois à la mystification.
Nous avons tous deux plongé dans la philosophie. Nous avons été également séduits par les Confessions d'Augustin. Mais ce personnage restera pour lui la figure dominante, et il ne réussira pas autant que moi à s'acclimater à la pensée rationnelle et systématique de Thomas d'Aquin. Ce qui m'impressionnait chez ce dernier, c'est la façon dont il se tourne vers la réalité empirique, vers la créature, en la soumettant à l'analyse rationnelle et à l'examen scientifique. À côté des philosophes, nous lisons tous les deux bien d'autres choses : les romans de Gertrud von Le Fort, d'Elisabeth Langgâsser, de Georges Bernanos, de Fiodor M. Dostoïevski, et, dans un registre philosophico-théologique, Romano Guardini, Josef Pieper, Theodor Hâcker, Peter Wust et Theodor Steinbüchel. Mais en même temps je m'intéresse énormément à la psychologie des profondeurs de C. G. Jung, ainsi qu'à l'art moderne, au marxisme-léninisme et à l'humanisme existentialiste de Jean-Paul Sartre.
Finalement, nous avons tous deux étudié intensivement la théologie, lui pendant trois ans, moi pendant cinq ans. Mais, dès le début de ses études universitaires, il songe à se consacrer à la théologie savante, car il doute de son aptitude au ministère pastoral, en particulier auprès des jeunes. Moi, j'entends entrer dans la pastorale, si possible des jeunes et en ville, ce pourquoi il me paraît dès le départ important d'acquérir une formation moderne universelle couronnée par un doctorat de théologie. Lui soutient sa thèse en 1953, à Munich, sur l'ecclésiologie d'Augustin (L'Église «peuple et maison de Dieu»); moi en 1957, à Paris, sur la doctrine de la «justification» de mon célèbre compatriote, Karl Barth, théologien réformé. Parmi les plus récents théologiens catholiques, je suis particulièrement impressionné par Henri de Lubac, Yves Congar et Karl Rahner.
Bien entendu nous nous intéressons tous deux particulièrement à l'exégèse de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Mais tandis que, étudiant à Rome, je fuis les exégètes rétrogrades de la Grégorienne pour me tourner vers l'Institut biblique pontifical, tout proche, où les professeurs osent s'appuyer sur l'Ecriture pour corriger et interpréter le dogme (ce pourquoi ils seront par la suite sanctionnés par le Saint-Office), Ratzinger, qui entend aussi à Munich des exégètes historico-critiques, fuit une exégèse à ses yeux trop « libérale » et recherche la sécurité. Tandis que je tente d'échapper à une dogmatique néoscolastique pétrifiée en me mettant en quête de la fraîcheur et de l'immédiateté de la Bonne Nouvelle chrétienne originelle telle qu'en témoigne le Nouveau Testament, lui cherche au contraire à se protéger de la critique exégétique par l'obéissance au dogme. Pour ma part, je puise directement ma force dans le message biblique; lui la trouve dans la doctrine.
C'est sur ce point que, théologiens catholiques, nous divergeons. La théologie de Ratzinger entend maintenir la critique biblique historique dans d'étroites limites : elle reste périphérique par rapport à la « construction » dogmatique. Pour ma théologie systématique, cette critique est fondamentale, car elle touche à la vérité historique de notre foi chrétienne. Nous ne voulions certes ni l'un ni l'autre en revenir à l'ancien libéralisme, mais je n'entendais pas non plus retourner à l'ancien dogmatisme. C'est bien là que se pose à nous le problème fondamental, celui du critère de base: la Bible ou le dogme? Est-ce que le dogme se situe au-dessus ou en dessous de l'Ecriture? Est-ce qu'il faut comprendre le Christ du dogme à partir du Christ de l'histoire, ou le contraire ?
(pages 25 à 27)
Qui sait ce qu'il en serait advenu de Joseph Ratzinger si, après trois années fructueuses, il n'avait quitté Tübingen. Jusque-là, nos deux parcours s'étaient déroulés de façon largement parallèle, et nous avions vraiment cheminé ensemble. Cependant, en dépit de la similitude de notre origine familiale et nationale, nous étions, structurellement de mentalité très différente. Très différente aussi était notre façon de comprendre la liturgie catholique, la théologie, la hiérarchie, en particulier l'exégèse biblique, ainsi que finalement la révélation et le dogme. En dépit ou à cause de ces différences, nous nous respections et nous estimions en tant que théologiens, nous reconnaissions la valeur mutuelle de notre foi et de notre vie intellectuelle. Nous admettions en somme qu'il peut y avoir deux façons, deux formes, deux styles, disons deux voies différentes de vivre le catholicisme.
À l'époque, cela ne nous était naturellement pas du tout aussi clair que ce l'est devenu par la suite. Cela n'aurait d'ailleurs absolument pas dû nous conduire à la rupture. Lui-même et Karl Rahner ne vivaient-ils pas sur deux planètes différentes, ainsi que cela fut manifeste durant le concile, et cela en dépit de leur « accord fondamental sur nombre de données et de souhaits » (p. 131) : à Ratzinger comme à moi-même, Rahner était apparu très vite comme dépassé, avec sa philosophie spéculative néoscolastique marquée par l'idéalisme allemand et par Heidegger, une philosophie où «l'Écriture et les Pères ne jouaient finalement pas grand rôle et où la dimension historique n'avait guère d'importance » (p. 131).
Face à Rahner, Ratzinger et moi-même étions par principe les représentants d'une théologie « entièrement définie par l'Écriture et les Pères, et d'une pensée essentiellement historique » (p. 131) ; mais avec une différence de plus en plus manifeste : Ratzinger défendait une théologie historico-organique qui ne tenait guère compte des ruptures et des déviations présentes dès l'origine ; il n'admettait de critique que dans le cadre hellénistique du dogme et il acceptait donc comme révélation divine « une tradition orale qui se déroulait à côté de l'Écriture» (p. 106). Inversement, je demandais que, tout comme la Bible, on soumette l'histoire des dogmes à la critique historique, et je défendais donc une théologie historico-critique mesurée à l'aune du message originel, du personnage et de la destinée de Jésus. Pour Ratzinger, le christianisme n'a vraiment commencé qu'avec la rencontre de l'Évangile et de la philosophie grecque. A ses yeux, une fois purifié par la critique, l'héritage grec constitue une partie essentielle de la foi chrétienne, ainsi que, devenu pape, il l'affirmera en 2006 lors de sa conférence de Ratisbonne. Ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament qui l'intéresse au premier chef; mais celle des Pères (évidemment sans Mères). Son souci théologique ne porte pas sur le Jésus de l'histoire - son livre Jésus de Nazareth le prouve surabondamment -, sur celui à partir duquel nous devons interpréter pour aujourd'hui les dogmes de l'Église. Il porte avant tout sur le Christ des conciles hellénistiques, et c'est à partir d'eux qu'il ne cesse d'interpréter les écrits néotestamentaires.
C'est ainsi que, désormais, tout en se recroisant sur certaines affaires importantes, nos itinéraires divergeront de plus en plus. Pour lui, l'année 1968 à Tübingen sera une année cruciale, comme d'ailleurs aussi pour moi, mais d'une tout autre façon. C'est là un nouveau chapitre qui me conduit à mettre fin à ce prologue pour jeter un premier regard sur l'évolution de la société et de l'Église catholique au lendemain du deuxième concile du Vatican et pour aborder les événements de cette année-là.